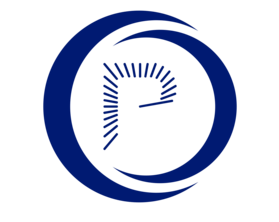7 aménagements simples pour prévenir les chutes et rester autonome plus longtemps.
Vieillir chez soi, dans un cadre familier, est le souhait de la grande majorité des personnes âgées. Mais à mesure que l’autonomie diminue, le logement peut devenir un obstacle au quotidien : escaliers dangereux, salle de bain inadaptée, manque d’éclairage, meubles encombrants…
Pour éviter les chutes, préserver l’autonomie et renforcer le sentiment de sécurité, il est essentiel d’adapter l’environnement domestique. Voici les principaux aménagements à connaître pour permettre aux seniors de vivre chez eux le plus longtemps possible – et en toute sécurité.
Pourquoi adapter son logement ?
L’adaptation du domicile n’est pas une question de luxe, mais une mesure préventive. En Suisse, une personne âgée sur trois chute chaque année après 65 ans. Les conséquences peuvent être graves : hospitalisation, fracture, perte d’autonomie… voire entrée prématurée en EMS.
Un logement bien pensé :
- Réduit les risques d’accident,
- Facilite les gestes du quotidien (se lever, cuisiner, se laver),
- Permet le maintien à domicile plus longtemps,
- Allège aussi la charge physique des proches aidants et des soignants.
Sécuriser les déplacements dans toute la maison
- Retirer les tapis glissants ou les fixer avec du ruban adhésif double face.
- Désencombrer les passages (couloirs, autour du lit, entrées).
- Installer des barres d’appui murales dans les endroits stratégiques (toilettes, couloir, escaliers).
- Prévoir un éclairage automatique ou à détection de mouvement, notamment dans les couloirs et toilettes la nuit.
- Remplacer les sols glissants par des revêtements antidérapants.
Adapter la chambre à coucher
- Lit à bonne hauteur (45-50 cm du sol) pour faciliter le lever et le coucher.
- Éviter les petits meubles près du lit (risque de trébuchement).
- Prévoir une table de nuit stable, avec téléphone à portée de main.
- Si nécessaire, envisager un lit médicalisé (prescrit par le médecin, souvent remboursé).
- Installer un tapis antidérapant fixe au sol, uniquement si indispensable.
Rendre la salle de bain plus sûre
La salle de bain est l’un des lieux les plus à risque pour les personnes âgées.
- Remplacer la baignoire par une douche de plain-pied avec sol antidérapant.
- Ajouter un siège de douche fixe ou mobile et des barres d’appui.
- Installer un mitigeur thermostatique pour éviter les brûlures.
- Placer les produits de toilette à portée de main pour éviter les gestes en déséquilibre.
- Prévoir un tapis de douche antidérapant, ou mieux, un sol spécifique.
Simplifier la cuisine
- Regrouper les ustensiles les plus utilisés à hauteur de taille.
- Éviter les rangements en hauteur ou au sol (réduire les mouvements pénibles).
- Installer une table stable avec des chaises solides (à accoudoirs si possible).
- Utiliser des plaques de cuisson à arrêt automatique, ou des systèmes de sécurité.
- Préférer les poignées de meubles faciles à saisir, plutôt que des boutons tournants.
Anticiper les besoins de mobilité réduite
Si la personne âgée utilise un déambulateur, une canne ou un fauteuil roulant, il est important :
- D’élargir les passages et d’ôter les obstacles au sol,
- D’ajuster la hauteur des meubles,
- D’envisager un monte-escalier si le logement comporte plusieurs étages,
- Ou, dans certains cas, de réorganiser les pièces de vie au rez-de-chaussée (installer la chambre au salon, par exemple).
Penser à l’accessibilité cognitive
Pour les personnes atteintes de troubles cognitifs (type Alzheimer ou démences) :
- Éviter les changements fréquents dans le mobilier et l’aménagement.
- Ajouter des repères visuels simples (photos, pictogrammes sur les portes).
- Marquer les zones importantes (ex. : flèche vers la salle de bain).
- Veiller à la cohérence entre les objets et leurs fonctions.
Existe-t-il des aides financières pour adapter son logement ?
Oui. Selon le canton, des aides peuvent être accordées pour l’aménagement du domicile :
- Assurance invalidité (AI) pour certaines aides techniques ou travaux,
- Prestations complémentaires (PC) qui tiennent compte des frais de soins et d’adaptation,
- Fondations ou caisses de compensation locales,
- Certaines communes offrent aussi un soutien ponctuel ou des conseils gratuits.
Il est recommandé de parler à son médecin, au CMS ou à un ergothérapeute pour évaluer les besoins et monter un dossier si nécessaire.
Et le rôle des proches aidants ?
Les proches jouent un rôle essentiel dans l’adaptation du logement. Ils peuvent :
- Observer les difficultés de la personne âgée,
- Proposer des solutions douces, non intrusives,
- Participer à la mise en place des aménagements,
- Et aider à maintenir un cadre de vie digne et rassurant, sans transformer la maison en “mini hôpital”.
Conclusion
Adapter le logement, c’est prévenir plutôt que subir. Ce sont souvent des ajustements simples qui permettent à la personne âgée de rester autonome, en sécurité, et chez elle aussi longtemps que possible.
Anticiper ces changements, c’est aussi soulager les proches, réduire les risques, et éviter des décisions dans l’urgence (hospitalisation, chute, placement prématuré).